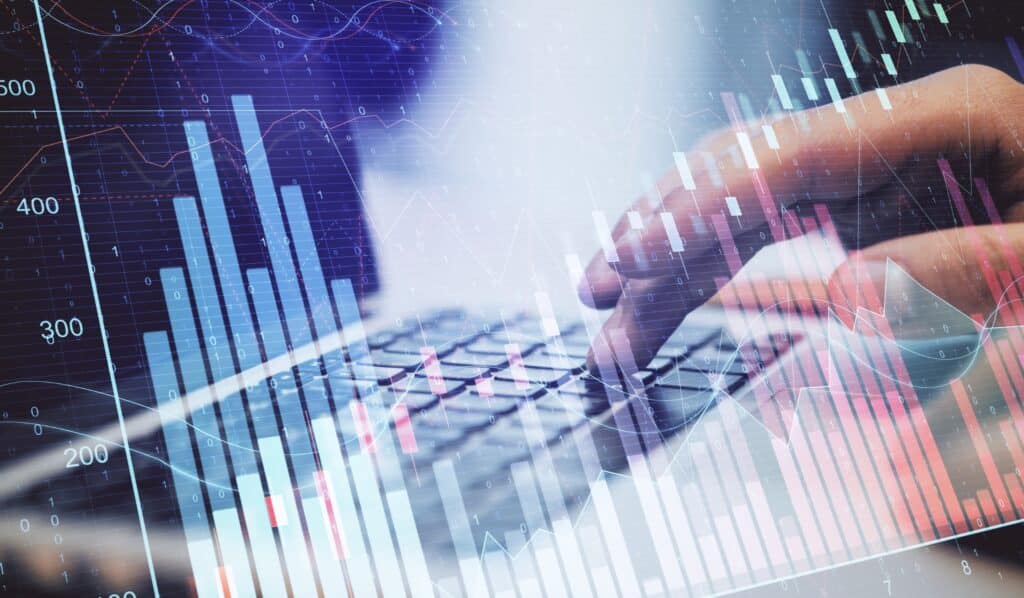Le management interculturel désigne l’ensemble des pratiques et postures permettant de diriger efficacement des équipes multiculturelles dans un contexte de diversité culturelle. Il est particulièrement vital dans un monde globalisé, où managers et organisations interagissent avec une multiplicité de valeurs, de modes de communication et de temporalités.
L’enjeu va bien au-delà de la simple tolérance : la diversité, qu’elle soit culturelle, de genre ou ethnique, s’impose aujourd’hui comme un facteur déterminant de performance. Une étude McKinsey, publiée en décembre 2023, démontre que les entreprises figurant dans le premier quartile en matière de diversité de genre et d’ethnicité sont 39 % plus susceptibles de dégager une rentabilité supérieure à la moyenne. Au sein des conseils d’administration, la diversité de genre accroît cette probabilité de +27 %, et la diversité ethnique de +13 %. Par ailleurs, chaque augmentation de 10 % de femmes au comité exécutif s’accompagne d’un gain d’1 point ESG, avec +2 points pour chaque femme supplémentaire dans un conseil d’administration de dix membres. Ces chiffres confirment que diversité et performance forment un cercle vertueux.
Des modèles pour décoder les cultures et mieux manager
« Les ressources humaines, d’autant plus à l’international, c’est avant tout travailler avec des personnes, les comprendre, et s’adapter à leur culture pour bien les accompagner : quand on dispose de ces savoir-faire, ils sont opérants dans tous les secteurs », témoigne Irma Galindo Tapia, DRH de transition chez Valtus, forte de son expérience avec plusieurs milliers de collaborateurs internationaux.
Cette approche s’appuie sur des modèles éprouvés :
Les six dimensions de Hofstede
Ces modèles éclairent aussi les pratiques managériales selon les contextes culturels : ils aident à ajuster style, modes de décision et management d’équipe selon le pays.
Selon les travaux originaux, le modèle s’appuie sur une enquête conduite auprès de plus de 100 000 employés répartis dans 70 pays chez IBM entre 1967 et 1973 .
- Distance hiérarchique (dans certaines cultures, les subordonnés questionnent volontiers leur hiérarchie ; dans d’autres, l’autorité demeure incontestée)
- Individualisme versus collectivisme (priorité à l’individu ou au groupe)
- Masculinité versus féminité (valorisation de la compétition ou de la coopération)
- Évitement de l’incertitude (confort avec l’ambiguïté ou besoin de structures claires)
- Orientation temporelle (vision stratégique long terme ou pragmatisme court terme)
- Indulgence versus retenue dans la gratification
Ce modèle aide les managers à anticiper la manière dont une équipe donnera du poids à l’autorité, structurera le débat ou réagira à l’incertitude – un outil précieux pour ajuster son style de leadership selon le contexte culturel.
Le modèle d’Edward T. Hall
Hall ajoute deux concepts fondamentaux. D’abord, la distinction entre cultures « haut contexte », dans lesquelles prime l’implicite posture, intonation, gestes, relations personnelles, et cultures « bas contexte » ; où le message doit être explicite, clair, sans ambiguïté. Une réunion sans ordre du jour sera ainsi jugée inefficace en Allemagne ou dans les pays nordiques, tandis qu’en Asie, au Moyen-Orient ou parfois en France, l’écrit importe moins que la qualité de la relation et la compréhension non-verbale.
Son second concept oppose temps monochrone (séquentiel, focalisé, respect des deadlines) au temps polychrone (fluidité, multitâche, imprévu toléré). Imaginez un manager suisse surpris de voir son homologue indien gérer cinq dossiers simultanément : ce n’est pas de l’indiscipline, mais une conception différente du temps.
L’approche Trompenaars & Hampden Turner
Cette approche va plus loin en approfondissant la réalité culturelle avec sept dimensions (universalisme versus particularisme, accomplissement versus attribution…) qui mettent en lumière les tensions vécues dans les relations. Faut-il respecter une règle ou privilégier une situation particulière ? Leur pensée par dilemme invite à réconcilier les opposés – créer de l’innovation tout en assurant la stabilité – plutôt qu’à choisir l’un ou l’autre.
Leur méthode « 4R » propose quant à elle un chemin clair : Reconnaître les différences, les Respecter, les Réconcilier et les Réaliser concrètement. Ils analysent également quatre cultures organisationnelles (Guided Missile, Eiffel Tower, Family, Incubator) qui invitent à équilibrer l’accent mis sur les tâches, les personnes, la hiérarchie et l’égalité selon les situations.
Piloter la transition interculturelle : retours d’expérience sur le terrain
Quand Shoyab Master, DAF de transition Valtus, a pris les commandes de la structure financière d’un grand groupe cosmétique britannique, le défi était de taille : stabiliser une équipe internationale en neuf mois.
« Durant cette mission, j’ai adopté une approche résolument opérationnelle. J’ai ajusté mes attentes vis-à-vis de l’équipe. J’ai simplifié et leur ai donné confiance ». Cette intervention visait à renforcer la cohésion au sein d’une équipe en pleine réorganisation. Au-delà des process, Shoyab Master insiste sur l’importance des compétences humaines : « En tant que manager de transition, vous êtes choisi pour votre expérience ainsi que pour vos connaissances techniques et commerciales. Mais ce qui fait vraiment la différence, c’est votre capacité à comprendre les gens et à travailler avec eux. Apprécier la diversité culturelle renforce cette compétence. Les éléments clés incluent l’écoute active, le questionnement et l’ouverture d’esprit ».
Adapter les structures aux cultures locales
Michael Masset, DRH de transition Valtus, a vécu cette réalité lors de la transformation de la fonction RH d’un leader technologique mondial actif dans 9 pays sur 6 mois. « Dans les entreprises internationales, il existe un différentiel culturel qu’il faut prendre en compte lors de la mise en place de vos structures RH, afin qu’elles soient adaptées à tous », souligne-t-il.
Cette adaptation ne relève pas du compromis mais de l’efficacité opérationnelle. Pour lui, « le défi de la fonction RH, c’est que vous devez vous transformer vous-même tout en aidant les autres à se transformer », une réalité amplifiée dans un contexte interculturel où « il faut standardiser les process au maximum tout en tenant compte de ce qu’aime faire un créatif dans le monde de la RH ».
Le rôle de pont culturel
Marc Thibiant, Directeur Général de transition Valtus, a incarné ce rôle lors du redressement d’une filiale pharmaceutique française d’un groupe suisse en difficulté sur 6 mois. « J’ai longuement travaillé dans un environnement multiculturel, ce qui me permet de comprendre comment gérer les attentes d’un actionnaire non-français. Mon rôle a également consisté à faire le pont, à apporter la perspective culturelle sur les difficultés de la France au management suisse et vice versa ».
Cette fonction de « traducteur culturel » entre maison-mère et filiales révèle une dimension stratégique du management interculturel : créer de la compréhension mutuelle pour débloquer les situations complexes.
Ces témoignages illustrent un principe fondamental : l’adaptation culturelle doit commencer dès le premier jour et se décliner à tous les niveaux de l’intervention.
Les compétences qui font la différence
Dans un environnement globalisé, posséder un haut niveau d’expertise technique ne suffit plus. Le manager interculturel doit déployer un éventail de compétences humaines et cognitives essentielles pour orchestrer des cultures variées vers un objectif commun.
L’intelligence culturelle : identifier ses propres biais pour mieux comprendre les autres. Cette sensibilité culturelle permet d’éviter les jugements hâtifs pour mieux comprendre les situations. « Il ne s’agit pas d’arriver avec toute sa connaissance pour faire les choses à sa manière, mais bien de faire alliance avec les gens », résume Irma Galindo Tapia, qui a coordonné plusieurs milliers de collaborateurs internationaux. Cette posture interculturelle s’apprend dès la prise de fonction, par l’écoute et l’humilité, avant même de déployer des compétences techniques ou des processus standardisés.
La communication adaptable : maîtriser les styles de communication est indispensable. Dans un monde haut contexte, l’essentiel ne se dit pas : il se lit dans le ton ou se comprend dans les silences. À l’inverse, dans un univers bas contexte, tout doit être explicite, clair, sans place à l’ambiguïté.
La communication interculturelle exige d’adapter styles et supports selon les cultures : certaines nécessitent un message très explicite, d’autres misent sur le non‑dit, le ton ou le contexte.
La flexibilité cognitive et émotionnelle : imprévu, sensibilité aux différences, adaptation constante constituent le quotidien d’un manager interculturel. Cette flexibilité va de pair avec la capacité à gérer l’ambiguïté et à transformer les conflits potentiels en opportunités.
La pensée par dilemme : selon Trompenaars, il s’agit de détecter les tensions comme stabilité versus innovation, et surtout de les réconcilier. En management interculturel, ce n’est ni l’un ni l’autre mais l’équilibre des deux qui fait sens. Ce savoir-faire alimente la cohésion de l’équipe et stimule la performance.
Le leadership inclusif : créer un sentiment d’appartenance, encourager les voix divergentes, éviter la domination d’un seul point de vue constituent le fondement du leadership interculturel. Celui-ci requiert la construction d’un environnement où chacun se sent légitime.
L’intégration business : l’efficacité repose sur la capacité à lier la diversité aux résultats. Il ne suffit pas d’être inclusif ; il faut aussi ancrer la diversité dans la stratégie locale et en mesurer l’impact. McKinsey recommande d’intégrer ces enjeux directement à la mission de l’entreprise, dans les résultats attendus et les processus existants.
La méthode en trois temps
Le timing est souvent serré en management de transition : une entreprise en transformation, des équipes à mobiliser, des cultures multiples à intégrer. Le défi est de taille ; la réponse doit être agile, interculturelle et durable.
Pour Irma Galindo Tapia, qui a coordonné la structuration RH internationale d’un leader mondial du BTP couvrant 60 000 collaborateurs dans 50 pays pendant 14 mois, la réussite internationale suit une logique claire : « Quand on est dans une logique corporate internationale, diffuser des consignes de façon descendante ne suffit pas… il faut répondre aux questions, ne pas se précipiter, et prendre le temps de comprendre ».
Sa mission illustre parfaitement un enjeu simple mais déterminant : installer des relations de confiance transnationales en alliant écoute, patience et rigueur.
Sa méthode structurée ?
- Diagnostic culturel : cartographier les pratiques locales (temps, communication, hiérarchie) et les confronter à celles du siège
- Communication multilatérale : mise en place de cercles de partage (réunions mensuelles, ateliers locaux), communication adaptative (mix de formats écrits et relations informelles)
- Suivi agile : suivi des retours pour corriger la démarche en cas de résistances culturelles
L’approche « 4R » de Trompenaars – reconnaître, respecter, réconcilier, réaliser – devient le fil rouge de l’intervention.
L’impact mesurable
Lorsque la culture locale est intégrée, la structure mise en place fonctionne. L’intervention de Shoyab Master à Londres a stabilisé l’équipe financière, permis d’atteindre les objectifs trimestriels et structuré des orientations stratégiques claires avec le CEO.
Forte de son expérience en tant que DRH internationale de transition, Irma Galindo Tapia a su instaurer des relais locaux durables grâce à des formations ciblées et une communication interculturelle structurée, démontrant que, même sur une mission courte, l’impact peut être profond et pérenne.
Les managers de transition, souvent arrivés dans un contexte de crise ou de mutation, doivent déployer ces compétences rapidement, avec précision, et savoir passer la main lorsque l’urgence est maîtrisée.
Car au final, le management interculturel en mission de transition n’est pas un luxe : c’est une condition de réussite opérationnelle qui convertit la diversité en avantage concurrentiel mesurable.
Sources :
– McKinsey & Company : Diversity matters even more : the case for holistic impact ; 5 décembre 2023
– Trompenaars Hampden-Turner models